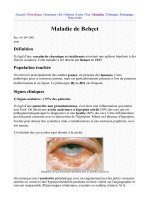MALADIES INFECTIEUSES - PART 5 ppt
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.66 MB, 27 trang )
• Chaque jour, au Québec, une personne meurt par arme à feu.
• La présence d’une arme à feu dans un domicile multiplie par cinq le risque
de décès par suicide, et par trois le risque de décès par homicide, sans
oublier le risque de décès par accident.
• À Montréal, en 1995, les armes à feu ont été responsables de 47% des
homicides et de 8% des suicides.
• Il est donc important de réduire l’accessibilité à une arme à feu pour les
personnes qui sont à risque d’en faire un mauvais usage.
• Le médecin traitant est parfois le mieux placé pour dépister la personne,
évaluer le risque et faire des recommandations appropriées.
Le cadre politique
Les décès par arme à feu préoccupent aussi
nos gouvernements.
En 1995, le Canada adoptait la
Loi sur les
armes à feu
obligeant tout utilisateur à
détenir un permis d’armes à feu à partir du
1
er
janvier 2001. Par ailleurs, d’ici le 1
er
janvier
2003, toutes les armes à feu existantes
devront avoir été enregistrées. Depuis le 1
er
décembre 1998, les nouvelles armes sont
enregistrées au moment de leur acquisition.
En 1998, le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec a élaboré une
stratégie d’action face au suicide qui identi-
fiait différentes orientations et interventions
dont la réduction de l’accès aux armes à feu.
1
révention
en pratique médicale
Juin 2001
LES DÉCÈS PAR ARME À FEU
Une arme à feu dans un foyer: un gros risque!
Une campagne de sensibilisation
pour la prévention des décès
par arme à feu a débuté
en avril 2001 au Québec.
Plusieurs décès par arme à feu
sont évitables par une action
de prévention posée au bon moment
auprès d’une personne à risque.
Vous êtes concerné.
Le rôle préventif qui nous revient
Le médecin, lorsqu’il est en présence d’un
patient montrant des signes de dépression,
des tendances suicidaires ou une prédispo-
sition à la violence, doit
notamment
chercher à savoir si ce patient a accès à
une arme à feu. Mais, avec ou sans la
présence d’une arme à feu dans
l’environnement du
patient,
le médecin
doit toujours poser
les actions appropriées
pour garantir la sécurité
de son patient et celle de
ses proches
.
Les armes à feu ne sont pas les seuls instruments impliqués dans les
décès par suicide ou par homicide.
Cependant, lorsque nous sommes en présence d’un patient suicidaire ou
qui présente une menace pour autrui, il faut toujours, entre autres,
questionner sur l’accès à une arme à feu.
2
Vous soupçonnez un risque
pour l’entourage
Questions à poser
• En voulez-vous à quelqu’un?
• Ces pensées vous troublent-elles
au point de poser des gestes
violents ou d’agresser quelqu’un?
• Quel moyen envisagez-vous?
Pensez aussi à demander
• Avez-vous accès à une arme à feu,
la vôtre ou celle de quelqu’un
d’autre?
Vous soupçonnez
un risque suicidaire
Questions à poser
• Pensez-vous à vous suicider?
• Quand pensez-vous le faire?
• Avez-vous pensé à un moyen (fusil,
médicaments, etc.) pour le faire?
• Comment allez-vous vous y prendre?
N’oubliez pas que plus le plan
est précis, plus l’urgence d’agir
est élevée.
Pensez aussi à demander
• Avez-vous accès à une arme à feu,
la vôtre ou celle de quelqu’un
d’autre?
La présence d’au moins un des facteurs suivants augmente le risque
d’homicide ou de suicide par arme à feu
La plupart des décès par arme à feu
surviennent à domicile
et impliquent des armes de chasse,
acquises légalement.
30% des suicides par arme à feu
impliquent une arme qui
n’appartient pas à la victime.
Vous soupçonnez être devant
une personne menacée
Questions à poser
• Votre partenaire ou quelqu’un
d’autre vous a-t-il déjà blessé(e),
poussé(e) ou maltraité(e)?
• Vous arrive-t-il de ne pas vous
sentir en sécurité ou d’avoir peur
de votre partenaire ou de
quelqu’un d’autre?
• Est-ce que votre partenaire ou
quelqu’un d’autre vous traite de
tous les noms ou essaie de vous
dicter vos moindres gestes?
Pensez aussi à demander
• La personne que vous craignez
a-t-elle accès à une arme à feu, la
sienne ou celle de quelqu’un d’autre?
• dépression;
• consommation abusive, actuelle ou
antérieure, de drogue ou d’alcool;
• antécédents de disputes violentes;
• séparation récente ou en cours;
• problèmes financiers;
• problèmes au travail;
• existence d’un dossier criminel.
QUAND s’inquiéter de l’accès à une arme à feu?
À propos du patient
En conformité avec la Loi sur la protection des per-
sonnes dont l’état mental présente un danger
pour elles-mêmes ou pour autrui (L.Q. 1997, c.
75, art 8), « Un agent de la paix peut, sans l’au-
torisation du tribunal, amener contre son gré une
personne auprès d’un établissement visé à
l’article 6:
1. à la demande d’un intervenant d’un service
d’aide en situation de crise qui estime que
l’état mental de cette personne présente un
danger grave et immédiat pour elle-même ou
pour autrui;
3
Chacune des situations à risque de décès par suicide ou par homicide est
unique et commande une intervention appropriée.
Notamment, lorsque l’accès à une arme à feu est confirmé, une action
doit être entreprise pour la soustraire de l’environnement de la personne
en situation de risque.
L’urgence d’agir
Vous pouvez négocier avec le patient, sa famille ou son entourage afin:
• que durant la période de crise, l’arme puisse être entreposée dans un endroit
sécuritaire
1
, hors de portée du patient;
OU
• que l’arme à feu soit confiée à un service de police pour être détruite, s’il s’agit
d’une arme qui n’est plus utilisée et devenue inutile;
OU
• d’obtenir un consentement pour demander aux autorités policières de retirer
temporairement l’arme, si personne d’autre ne peut le faire légalement
2
.
1 Pour qu’une personne de la famille ou de l’entourage puisse légalement prendre en charge une arme ou des munitions, elle doit elle-même
détenir un permis d’armes à feu. Lorsque l’arme est une arme de poing (revolver ou pistolet), il faut obligatoirement faire une demande
d’autorisation de transport au contrôleur des armes à feu (numéro de téléphone à la page 4) car nul ne peut transporter une telle arme
sans cette autorisation.
2 À ce moment, en conformité avec l’article 111 du
Code criminel, un juge de la Cour provinciale sera saisi de l’affaire et déterminera la
durée et le lieu de l’entreposage.
2. à la demande du titulaire de l’autorité
parentale, du tuteur au mineur ou de l’une
ou l’autre des personnes visées par l’article
15 du Code civil du Québec
4
, lorsqu’aucun
intervenant d’un service d’aide en situation
de crise n’est disponible, en temps utile, pour
évaluer la situation. ( ).»
Abordez avec elle la question de sa
protection. Demandez-lui si,
advenant que la situation s’aggrave
et que la menace devienne plus intense,
elle a songé aux points suivants:
• Si vous deviez rapidement quitter
la maison, avez-vous prévu un
scénario d’urgence?
• Avez-vous quelqu’un sur qui vous
pouvez compter, un endroit pour
vous réfugier?
• Avez-vous quelqu’un à qui vous
pouvez en parler?
• Savez-vous qu’il existe des
ressources
3
pour vous aider?
À propos de l’arme
En conformité avec les paragraphes 117-04 (1)
et (2) du Code criminel, « Le juge de paix peut,
sur demande d’un agent de la paix, délivrer un
mandat de perquisition autorisant la saisie des
armes (…) lorsqu’il est convaincu qu’il existe
des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas
souhaitable pour la sécurité de cette personne,
ou pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets. »
De plus, « Lorsque (…) l’urgence de la situation,
(…), rend difficilement réalisable l’obtention d’un
mandat, l’agent de la paix peut, sans mandat,
perquisitionner et saisir les armes (…).»
Devant un patient apte présentant un risque
pour lui-même ou pour autrui
3 Pour ces ressources précises, vous référer à la fiche # 5, Violence
faite aux femmes, dans le cartable
Prévention en pratique médicale.
Devant une personne menacée
4 Art. 15. « Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux soins
requis par son état de santé est constatée, le consentement est
donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n’est
pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint ou,
à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un
proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un
intérêt particulier. »
Dans le cas où le patient est inapte ou lorsque la collaboration du patient, de sa famille ou de son entourage est
impossible, il faut alors signaler le risque, pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui, à un agent de la paix
qui prendra les dispositions qui s’imposent.
4
Association
des Médecins
Omnipraticiens
de Montréal
Un bulletin de la Direction de la santé publique
de Montréal-Centre publié avec la collaboration de
l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal
dans le cadre du programme Prévention en pratique médicale
coordonné par les docteurs Jean Cloutier et Serge Nault.
Ce numéro est une réalisation de l’unité
Écologie humaine et sociale.
Responsable de l’unité : Francine Trickey
Rédacteur en chef : D
r
Serge Nault
Édition : Yves Laplante
Infographie : Manon Girard
Rédacteurs : D
r
Serge Nault, Francine Trickey,
Amélie Baillargeon
Collaborateurs : Violaine Ayotte, Marthe Laurin,
Carole Poulin, Yvonne Robitaille,
D
r
Yann Cosma, D
r
Jean-Pierre Villeneuve
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1M3
Téléphone : (514) 528-2400
Courriel :
Dépôt légal – 2
e
trimestre 2001
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1481-3734
Numéro de convention : 1455958
révention
en pratique médicale
• Service de police de la Communauté
urbaine de Montréal (SPCUM)
Si vous faites face à un danger
immédiat et sérieux :
911.
• Centre canadien des armes à feu
et le Contrôleur des armes à feu :
Ligne sans frais
1-800-731-4000
Une ressource pour les conjoints
des propriétaires d’armes à feu ou
toutes autres personnes qui auraient
des inquiétudes relativement à leur
sécurité.
• Sûreté du Québec
24 heures / 7 jours,
partout au Québec,
sans frais d’interurbain :
310-4141, cellulaire : *4141.
•
Liens internet pour informations
Centre Canadien des armes à feu
www.ccaf.gc.ca
Coalition pour le contrôle des
armes www.guncontrol.ca
•
Pour commander des exemplaires du
feuillet
« Les armes et vous : êtes-
vous à l’abri du drame? »
(418) 545-9110.
Le secret
professionnel
L’article 3.04 du Code de déontologie
des médecins
stipule que
« Le médecin peut cependant
divulguer les faits dont il a eu person-
nellement connaissance, lorsque le
patient ou la loi l’y autorise, lorsqu’il
y a une raison impérative et juste
ayant trait à la santé du patient ou de
son entourage ».
C’est ainsi que le droit des patients à la
confidentialité des informations recueillies
par un médecin
peut être mis de côté par
ce dernier en faveur notamment de certains
impératifs de sécurité publique.
Une balise juridique
La Cour suprême du Canada dans une décision
récente originant de la Colombie-Britannique
(Smith
c. Jones, 1999) a identifié trois
critères qui doivent être présents afin de
permettre à un professionnel de se sous-
traire en toute légalité à son obligation de
confidentialité :
1. Une personne ou un groupe de personnes
clairement identifiable est exposé à un
danger.
2. Le danger pour ces personnes est d’être
gravement blessées ou tuées.
3. Le danger doit être imminent, c’est-à-
dire qu’il inspire un sentiment d’urgence
parce qu’on perçoit ce risque comme
étant très sérieux.
Toutefois, le premier critère devra être inter-
prété avec souplesse lorsque les deux
derniers sont très nettement présents lors de
l’entrevue : par exemple, le patient menace
sérieusement de tuer la prochaine personne
à croiser son chemin ou à le contredire
publiquement.
En tout temps
Lorsqu’un patient fait allusion à
l’utilisation ou à la possession d’armes
à feu (par exemple, il mentionne qu’il
s’adonne à la chasse ou qu’il est
collectionneur), il faut profiter de ce
moment pour aborder les règles élé-
mentaires de sécurité concernant
l’entreposage et la manipulation des
armes à feu.
À cette occasion, vous pouvez lui offrir
(ou suggérer de se procurer) le dépliant
« Les armes et vous : êtes-vous à
l’abri du drame? »
Ressources et information
Il y a 4,7 fois plus
de risque de suicide
et 2,7 fois plus de risque
d’homicide dans une maisonnée
où une arme à feu est présente
que dans celle où il n’y en a pas.
Bien que depuis une quarantaine d’années il n’y a eu que deux cas de rage humaine au Québec, son spectre réapparaît à l’esprit du médecin chaque fois qu’il
est confronté à un cas de morsure animale. Or, on sait qu’après une morsure, si une prophylaxie est entreprise rapidement, la rage demeure évitable. Mais si
les symptômes apparaissent, l’issue est toujours la même, fatale.
Par ailleurs, compte tenu des effets secondaires du vaccin et de l’absence de la rage animale sur notre territoire chez les animaux terrestres, la prophylaxie
contre la rage n’est en fait indiquée que rarement à Montréal. Plusieurs facteurs déterminent la pertinence de la prophylaxie post exposition (PPE). Les algo-
rithmes ci-joints systématisent l’analyse de ces facteurs pour faciliter la décision. Les textes qui suivent en illustrent l’utilisation dans différentes situations
et développent différents éléments de la problématique.
Les éléments-clés
Cinq principaux facteurs sont à considérer et à
soupeser dans la décision d’entreprendre une prophy-
laxie post exposition contre la rage :
• le type d’exposition,
• le type d’animal,
• la disponibilité de l’animal,
• le secteur géographique,
(quand il s’agit d’animaux domestiques),
• l’état de santé et le comportement
de l’animal.
Les algorithmes détailleront ces facteurs, mais
voyons d’abord certaines lignes directrices générales:
Animal domestique
Lorsqu’un animal domestique est en cause et peut
être retracé, l’observation de l’animal (par l’ACIA)
pendant 10 jours sera l’intervention à privilégier.
É c u r e u i l
Les morsures d’écureuil font souvent l’objet de
consultations mais la PPE n’est pas indiquée dans ces
cas. En effet, la morsure d’écureuil ou d’un autre
petit rongeur ne nécessite pas de PPE sauf s’il y avait
attaque non provoquée faite par un rongeur furieux
et agressif. On allègue que les petits rongeurs ne
peuvent survivre aux traumatismes infligés par la
morsure d’un animal enragé et par le fait même
meurent avant de pouvoir transmettre la rage.
Animal sauvage et chauve-souris
Lorsqu’un animal sauvage ou une chauve-souris e s t
en cause, la prudence est de rigueur.
1
M
ALADIES INFECTIEUSES
Morsures animales
Quand offrir la prophylaxie post exposition contre la rage
La ra g e , une maladie des mammifères
et il y en un qui vole : la chauve - s o u r i s
Cas de rage animale
Par Claude Goyer, vétérinaire de district, intérimaire, ACIA
Au Québec, en 2001, 18 cas positifs de rage animale (9 renards, 8 chauves-souris et 1 chien)
furent diagnostiqués et la majorité (14) furent trouvés dans le Nord du Québec.
Dans le district de Montréal-Laurentides-Lanaudière dont l’île de Montréal fait partie, de 1997 à
2001, seulement des chauves-souris (9) ont été retrouvées rabiques. Celles-ci sont souvent trouvées
mortes dans la maison (sous-sol, salle de bain, etc.) ou le garage et soumises pour analyse au
laboratoire de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
Endroit Espèce infectée Année
Rosemère Chauve-souris 97
St-Hermas (Mirabel) Chauve-souris 99
St-André d’Argenteuil Chauve-souris 00
St-Roch-de-L’Achigan Chauve-souris 01
Ste-Sophie Chauve-souris 01
Laval Chauve-souris 01
Pointe-Claire Chauve-souris 01
Rosemère Chauve-souris 01
Ste-Geneviève Chauve-souris 01
* * *
Par ailleurs, en janvier 2002, un raton laveur a été trouvé infecté par le virus de la rage de la
chauve-souris à l’Île Perrot.
réve n t i o n
en pratique médicale
1
J u i n 2 0 0 2
2
P r é v e n t i o n e n p r a t i q u e m é d i c a l e , J u i n 2 0 0 2
Animal domestique
Un joggeur de 25 ans, dans un sentier sinueux à
Montréal, a croisé deux chiens enjoués. Il a continué
sa course mais les chiens l’ont poursuivi et l’un
d’eux l’a mordu au mollet. Leur maître les a appelés
et ils ont déguerpi. Les traces de crocs ayant percé
la peau sont bien visibles. Après un nettoyage de
la plaie, vous lui administrez un rappel de d
2
T
5
puisque sa dernière dose remonte à l’âge de 15
ans. Faut-il lui prescrire la PPE?
• Type d’exposition : morsure avec perfo-
ration de la peau.
• Type d’animal : chien domestique.
• Disponibilité de l’animal : non.
• Secteur géographique : Montréal. Un appel
à l’ACIA (450-476-1223) précise que la
rage est absente du secteur chez les mam-
mifères terrestres.
• Santé et comportement de l’animal : le
vétérinaire considère que les chiens en
question semblaient excités (pas inexpli-
cablement agressifs) et en bonne santé.
• Décision : pas de PPE.
Animal sauvage
Un enfant d’une dizaine d’années s’est fait mordre
quand il a voulu toucher à un raton laveur qui
fouillait dans une poubelle à Montréal. En s’en-
fuyant le raton laveur a été frappé mortellement
par une voiture et son corps mis à la poubelle.
Doit-on entreprendre une PPE ?
• Type d’exposition : morsure profonde.
• Type d’animal : raton laveur (animal
sauvage).
• Disponibilité de l’animal : oui.
• Santé et comportement de l’animal : vous
contactez l’ACIA (450-476-1223) qui vous
assure que le résultat d’analyse du cerveau
du raton laveur peut être obtenu en moins
de 48 heures.
• Décision temporaire : pas de PPE en
attendant le résultat.
• Décision finale : pas de PPE, le résultat
d’analyse s’avérant négatif.
Petit rongeur
Une mère vous consulte parce que son enfant âgé
d’un an et demi s’est fait mordre par un écureuil.
Ceci s’est passé alors que la famille était en cam-
ping en Ontario. Un matin, un écureuil s’est
pointé. L’enfant était assis par terre et on a déposé
de la nourriture près de l’enfant, l’écureuil est allé
la chercher. Le lendemain, l’enfant a tenté de
nourrir l’écureuil. Alors que celui-ci s’apprêtait à
prendre la nourriture, le frère s’est approché,
l’écureuil s’est senti coincé, a pris peur, a mordu
un doigt de l’enfant en s’emparant de la nourri-
ture. Doit-on administrer la PPE à l’enfant?
• Type d’exposition : morsure.
• Type d’animal : écureuil (petit rongeur).
• Disponibilité de l’animal : non.
• Santé et comportement de l’animal : l’ani-
mal ne semblait pas en mauvaise santé et
n’a pas agi par agressivité mais plutôt par
p e u r .
• Décision : pas de PPE.
Histoires de cas
Morsures et PPE
Cas de rage humaine
Le dernier cas de rage humaine au Canada
est survenu chez un enfant infecté par une
chauve-souris lors d’un séjour dans un
chalet dans les Laurentides en 2000.
Le cas canadien précédent date de 1985,
attribuable à une morsure de chauve-souris
dans le nord de l’Alberta.
Au Québec, l’avant-dernier cas remonte à
1964; il s’agissait d’une jeune fille mordue
par une mouffette.
Ces personnes sont décédées : elles
n’avaient pas consulté de médecin après
leur exposition et elles n’avaient pas reçu de
prophylaxie post exposition contre la rage.
C h a u ve- s o u r i s
Un garçon de 8 ans accompagné de sa mère vous
consulte. L’enfant a trouvé une chauve-souris par
terre en revenant à la maison après l’école. Il l’a
manipulée. Vous examinez les mains de l’enfant et
vous ne voyez aucune marque de morsure ni autre
plaie. Est-ce que la PPE est indiquée?
• Type d’exposition : plausible.
• Type d’animal : chauve-souris.
• Disponibilité de l’animal : incertaine.
• Santé et comportement de l’animal :
dans les circonstances vous consultez
la DSP (514-528-2400) pour un avis.
La DSP contacte l’ACIA qui dépêche un
inspecteur sur les lieux craignant que
d’autres enfants n’aient aussi manipulé
cette petite bête intrigante.
• Décision temporaire : commencer la PPE.
Il ressort de l’enquête de l’ACIA que trois
autres enfants avaient aussi manipulé
cette chauve-souris à demi-paralysée dans
la cour d’école. De plus, une dame avait
recueilli la chauve-souris et l’avait mise
dans une cage pour en prendre soin!
• Décision finale : PPE à 5 personnes.
L’ACIA a pu faire analyser la bête, le
résultat s’est avéré positif. Grâce à votre
appel, l’ACIA et la DSP ont pu entrepren-
dre des démarches de prévention essen-
tielles auprès de 4 autres personnes.
Retour de voya g e
À la suite d’une morsure survenue à
l’étranger, la PPE sera souvent recommandée
puisque dans de nombreuses régions du
monde la rage est à l’état enzootique.
Par ailleurs, le plus tôt est le mieux mais la
PPE peut être entreprise même après un
long délai suivant l’exposition.
La période d’incubation de la rage chez
l’humain se situe habituellement entre 20 et
60 jours, toutefois elle peut varier d’une
dizaine de jours à plusieurs années.
En cas de doute, contacter la DSP (514-528-
2400) pour vérification du niveau de risque
dans la région visitée.
3
La prophylaxie post exposition contre la rage
L avage de la plaie + RIG + va c c i n
Le plus tôt possible mais il n’est jamais trop tard
pour l’entreprendre
• Le lavage minutieux de la plaie avec de l'eau
et du savon pendant plusieurs minutes réduirait
le risque de rage de près de 90 %. Ensuite, si
possible, appliquer de l’éthanol à 70% ou de la
povidone iodée (ex. : proviodine).
• Les immunoglobulines contre la rage, commu-
nément appelées RIG, à la dose de 20 UI/kg,
s'administrent en même temps que la première
dose de vaccin (ou moins de 8 jours après la 1
re
dose). On infiltre la plus grande quantité possible
de la dose autour et dans la plaie et on administre
le reste par voie IM dans le muscle dorso-fessier
ou le vaste externe de la cuisse loin du point
d’inoculation du vaccin (en utilisant une autre
seringue et une autre aiguille). Si la dose calculée
selon le poids apparaît insuffisante pour infiltrer
toutes les plaies, on peut diluer les RIG dans un
volume de soluté physiologique équivalant au
double, voire au triple de celui de la dose.
• Cinq doses de 1 ml du vaccin contre la rage
échelonnées sur une période d'un mois (jours 0,
3, 7, 14, 28) doivent être administrées dans le
muscle deltoïde (ou dans le vaste externe chez
le nourrisson) en respectant les intervalles.
Pour plus de détails, se référer au Protocole
d'immunisation du Québec.
P a r ticularité quand une chauve-souris est en cause :
en l’absence d’évidence de plaie localisée, l’admi-
nistration de la totalité des RIG se fait par voie IM
dans le muscle dorso-fessier ou le vaste externe de
la cuisse.
Les RIG et le vaccin sont disponibles dans la
plupart des centres hospitaliers de soins
généraux.
Note : Vérifier l’immunisation contre le tétanos.
Manifestations cliniques possibles lors d’une PPE
Immunoglobulines contre la rage (RIG)
Dans la majorité des cas les RIG ne provoquent
aucune réaction.
Le vaccin
Cependant, les manifestations cliniques rapportées
à la suite de l’administration du vaccin contre la
rage sont relativement fréquentes comparative-
ment à celles associées aux vaccins de l’immunisa-
tion de base.
Manifestations attendues :
• Réactions locales au site de l’injection (30 à
74% des personnes vaccinées).
• Réactions généralisées : céphalées, nausées,
douleurs abdominales, douleurs musculaires,
étourdissements (environ 20%).
• Réactions anaphylactiques (0.01%).
• Urticaire généralisée associée ou non à de l’angio-
œdème, des douleurs articulaires, de la fièvre,
des nausées, des vomissements et des malaises
(7% environ après une dose de rappel comme
il se donne en de rares circonstances,
ex.: spéléologues).
Manifestations signalées :
• En 1998, aucune réaction n’a été rapportée.
• Au cours des années 1999 et 2000, certains
effets secondaires possiblement reliés à l’immu-
nisation (ESPRI) ont été rapportés après une
vaccination contre la rage.
◆
En 1999, une réaction d’allure urticarienne
a été rapportée lors de l’administration
d’une première dose de vaccin. La vaccina-
tion n’a pas été poursuivie par la suite.
◆
En 2000, il y a eu une augmentation impor-
tante du nombre de signalements d’exposi-
tion à des chauves-souris à la suite d’un cas
de rage humaine survenu à l’automne 2000
au Québec entraînant une augmentation
justifiée de PPE (1051 doses de vaccin
distribuées à Montréal). Sur 12 incidents
signalés, les manifestations cliniques rap-
portées et qui furent sans séquelles, étaient :
- fièvre (5 cas),
- réaction locale au site de l’injection (1 cas),
- réactions de type allergique (3 cas) dont
un syndrome de Stevens-Johnson,
- éruptions cutanées (2 cas),
- arthralgie (1 cas),
- anesthésie-paresthésie (1 cas).
Le suivi des doses subséquentes a pu être
fait pour 4 de ces 12 personnes : aucune
autre manifestation ne s’est produite.
En collaboration avec le médecin traitant et l’ACIA,
la DSP peut:
• aider à la décision d’entreprendre une PPE ou non,
• assurer le suivi d’une analyse demandée sur un
a n i m a l ,
• procéder à une enquête élargie auprès d’autres
personnes si nécessaire.
Pour contacter la DSP : 514-528-2400
Le rôle de la Direction
de santé publique
L’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) est, au Canada, l’instance chargée entre
autres de :
• faire enquête sur tous les cas suspects de rage
animale qui ont été signalés;
• poser un diagnostic dans tous les cas soupçonnés
d’un contact possible avec un humain ou un ani-
mal domestique;
• mettre en quarantaine les animaux domestiques
s o upçonnés d'être enragés ou à risque, pour
e m p ê c h e r le contact avec des humains ou d'autres
animaux;
• répondre aux demandes d’analyse diagnostique
de cas soupçonnés de rage chez les animaux
sauvages (si contact possible) ou les animaux
domestiques dont la grande majorité sont
urgentes à cause des risques de transmission aux
humains.
La rage animale est une maladie à déclaration
obligatoire. Cela signifie que si vous soupçonnez
qu'un animal est enragé ou si vous pensez que
votre animal a été exposé à la rage, vous êtes tenu
par la loi de le signaler à l’ACIA.
Pour contacter l’ACIA: 450-476-1223
Le rôle de L’AC I A
Par Claude Goyer, vétérinaire de district,
intérimaire, ACIA
La maladie est due à un virus qui se transmet par
la salive du mammifère atteint. Les symptômes de
la rage sont d’ordre neurologique : changement
marqué de comportement, agressivité, tendance à
mordre ou comportement amorphe et abattement.
L’animal ne peut plus avaler, c’est pourquoi il bave
abondamment : c’est le signe classique de la rage.
La paralysie survient rapidement et l’animal meurt
en quelques jours.
Symptômes de la rage
chez l’animal
3
P r é v e n t i o n e n p r a t i q u e m é d i c a l e , J u i n 2 0 0 2
Association
des Médecins
Omnipraticiens
de Montréal
4
P r é v e n t i o n e n p r a t i q u e m é d i c a l e , J u i n 2 0 0 2
Un bulletin de la Direction de santé publique
de Montréal-Centre publié avec la collaboration de
l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal
dans le cadre du programme Prévention en pratique médicale
coordonné par le docteur Jean Cloutier.
Ce numéro est une réalisation de l’unité
Maladies infectieuses.
Responsable de l’unité : D
r
John Carsley
Rédactrice en chef : D
r
Monique Letellier
Édition : Blaise Lefebvre
Infographie : Manon Girard
Rédactrice : D
r
Doris Deshaies
Collaborateurs : D
r
André Vallières, D.M.V.
D
r
Claude Goyer, D.M.V.
D
r
Michèle Tremblay
D
r
Jean-Pierre Villeneuve
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1M3
Téléphone : (514) 528-2400, télécopieur : (514) 528-2452
courriel:
Dépôt légal – 2
e
trimestre 2002
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1481-3734
Numéro de convention : 40005583
La rage chez le raton lave u r
par André Vallières, vétérinaire, ACIA
H i s t o r i q u e
Au début des années 50, une épizootie de rage
chez le raton laveur a été confirmée en Floride. La
maladie s’est ensuite dispersée chez cette espèce
sur un territoire englobant la Floride, l’est de
l’Alabama, la plus grande partie de la Georgie et la
Caroline du Sud. Vers la fin des années 70, une
deuxième épizootie est apparue dans les états de
la région du nord-est des États-Unis. Cette dernière
épizootie a débuté à la frontière entre la Virginie
de l’Ouest (1977) et la Virginie (1978). Elle s’est
répandue dans le nord de la Virginie, puis au
Maryland (1981), en Pennsylvanie (1982), au
Delaware (1987), au New Jersey (1988), à l’état de
New York (1990), au New Hampshire (1993) et au
sud du Vermont (1993).
En 1995, des représentants du ministère de
l’Environnement et de la Faune du Québec, du
ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec, du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, de la
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de
Montréal et d’Agriculture et agro-alimentaire
Canada (maintenant l’Agence canadienne d’inspec-
tion des aliments) ont confié à un comité scien-
tifique le mandat d’évaluer les risques d’extension
de cette épizootie au Québec et de mesurer l’im-
pact d’une telle épizootie sur les animaux
sauvages, les animaux domestiques et les humains
des régions susceptibles d’être touchées. Le comité
a ensuite formulé des recommandations qui ont
mené dans un premier temps les autorités à colla-
borer avec les états américains limitrophes dans
leurs efforts visant à ralentir la progression de
l’épizootie. Depuis 1999, le Québec a procédé à la
mise en place d’une barrière vaccinale sur son pro-
pre territoire, à la frontière avec l’état du Vermont.
À date, aucun cas de rage associé à la variante du
raton laveur n’a été diagnostiqué au Québec.
En 1999, la rage du raton laveur a fait son appari-
tion en Ontario et en 2000, elle a été détectée au
Nouveau-Brunswick. Dans les deux cas, des plans
visant à contrôler l’épizootie ont été mis en
o e u v r e .
Le virus de la rage
La virus de la rage peut affecter tous les mam-
mifères. Il existe plusieurs variantes du virus de la
rage, selon leur association à différentes espèces.
Par exemple, la variante du renard arctique, la varia n t e
du raton laveur responsable de l’épizootie décrite
ci-haut et la variante de la chauve-souris. Il faut
cependant garder en tête que toutes ces variantes
peuvent affecter l’une ou l’autre espèce de mam-
mifères (incluant l’homme). Ainsi, même si la variante
du raton laveur n’a jamais été observée au Québec,
des ratons laveurs ont été atteints par le passé par
les variantes du renard ou de la chauve-souris.
Transmission de la rage
Le virus de la rage est transmis par la salive de
l’animal enragé, principalement au moment d’une
morsure ou au contact de la salive avec une plaie
ou une muqueuse. Un animal enragé peut excréter
du virus dans sa salive jusqu’à dix jours avant le
début des symptômes. Cette période peut être plus
longue dans le cas de la chauve-souris.
Manifestations cliniques de la rage
Les premiers signes habituellement observés chez
un animal atteint de rage sont le changement de
comportement et la perte de l’instinct de conserva-
tion. Un raton laveur anormalement familier avec
un humain doit éveiller les soupçons. On notera
également une démarche chancelante, la désorien-
tation et l’apparition d’une paralysie, touchant
d’abord les membres postérieurs mais progressant
rapidement aux membres antérieurs. Salivation
abondante et difficulté de déglutition sont sou-
vent présentes. La maladie est presque toujours
fatale, la mort survenant en 4 à 6 jours au plus.
Pr é ve n t i o n
Il faut toujours être très prudent quand on est en
présence d’un raton laveur. Éviter tout contact
avec ce type d’animal. En cas de contact ou de
morsure accidentelle, laver immédiatement la plaie
et consulter un médecin sans tarder. Si possible,
conserver l’animal et aviser un bureau de l’Agence
canadienne d’inspection des aliments, qui
procédera à des prélèvements et à des analyses en
vue de vérifier la possibilité de rage.
S u r v eillance active de la rage du
raton lave u r
Un plan de surveillance accrue des ratons laveurs
est en place dans une région de la Montérégie et
de l’Estrie depuis quelques années, dans le but de
dépister rapidement l’introduction de la rage du
raton laveur au Québec. Cette bande d’environ 20
kilomètres est située au nord de la frontière avec
le Vermont, et s’étend de la frontière ontarienne à
l’ouest jusqu’à la frontière du New Hampshire à
l’est. Les ratons laveurs au comportement anormal
ou décédés doivent être signalés à la centrale
d’alerte (SOS Braconnage) de la Société de la faune
et des parcs du Québec, au 1-800-463-2191.
réve n t i o n
en pratique médicale
w w w. s a n t e p u b - m t l . q c. c a
réve n t i o n
en pratique médicale
c ’est aussi une chronique
bimensuelle Internet
1- À confirmer par un vétérinaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) : (450) 476-1223.
2- Circonstances très particulières : ex. : attaque sans raison par un animal furieux et agressif, mauvais état de santé compatible avec les symptômes de la rage animale
1
.
3- Provocation manifeste : morsure infligée lors d'un jeu, lorsque l'animal est nourri, puni ou même caressé contre sa volonté ou lorsqu'on le sépare d'un autre animal avec lequel il s'accouplait ou se battait.
Édition : Direction de santé publique de Montréal-Centre - mai 2002 (adapté du document du MSSS 1996) Précisions au verso
INDICATION DE LA PROPHYLAXIE POST EXPOSITION CONTRE LA RAGE (PPE)
Morsure
ou contact d'une plaie ou d'une muqueuse
avec salive, LCR ou tissus nerveux
d'un MAMMIFÈRE
Animaux domestiques, de compagnie et bétail
chien, chat, furet, cheval, bovin…
Animaux sauvages
raton laveur, mouffette, renard,
marmotte, lynx, coyote…
Disponible
Petits rongeurs
écureuil, tamia, souris, rat, gerboise,
hamster, mulot, lapin…
Chauve-souris
PPE
Observation de l'animal X 10 jrs
après le contact
sous supervision de l'ACIA
Mauvais état de
santé et comporte-
ment inhabituel
durant ou
à la fin de
l'observation
1
PPE
Animal non rabiqueAnimal rabique
Bon état de
santé à la fin de
l'observation
1
Pas de PPE
Cesser PPE si
commencée
PPE
Pas de PPE
sauf si
circonstances
très
particulières
2
Consulter
la DSP dans
tous les cas
(514)
528-2400
AIDE À LA DÉCISION
Non disponible
Disponible ou non disponible
Disponible
Commencer la PPE immédiatement
sauf si
le résultat d’analyse du cerveau de l’animal
peut être obtenu en < 48 h après le contact
et
qu'il n'y a pas de rage dans ce secteur
1
Disponible ou non disponible
Non disponible
Secteur
enzootique
pour la
rage
1
Secteur
exempt de
rage
1
Pas de PPE
sauf si
circonstances
particulières
2
ou
mauvais état
de santé
compatible
avec la rage
1
PPE
sauf si
provocation
manifeste
3
et
animal en
bonne santé
1
Mauvais état
de santé et
comportement
inhabitue
l
1
Bon état
de santé et
comportement
habituel
1
D
D
C
C
B
B
A
A
Certitude
de morsure
ou autre
exposition
significative
Exposition
plausible
TYPE
D’EXPOSITION
TYPE
D’ANIMAL
DISPONIBILITÉ
de
L’ANIMAL
SECTEUR
(ANIMAL
DOMESTIQUE)
DÉCISIONS et SUIVIS
D
Exposition
non
significative
Pas de PPE
A. Animaux domestiques
La grande majorité des morsures sont infligées par
les animaux domestiques, notamment le chien.
!
! Animal disponible
L'observation de l'animal, sur place ou à distance,
pendant 10 jours par un vétérinaire de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est la
pratique recommandée lorsqu'il s'agit d'un animal
domestique disponible dont on connaît le proprié-
taire.
Veuillez donner le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone du propriétaire de l'animal en plus des
coordonnées de la victime en contactant l'ACIA au
numéro 450-476-1223 durant les heures ouvrables
ou en envoyant une télécopie au 450-476-1416.
!
! Si l'animal est vivant, faire avertir de ne pas le
tuer et qu'un vétérinaire de l'ACIA procédera à
l'évaluation de la situation et à l'observation de
l'animal sur place ou à distance.
!
! Si l'animal est mort, la carcasse doit être
gardée au frais pour analyse ultérieure.
!!
!!
Animal non disponible
Si l'animal domestique n'est pas disponible, par
exemple s'il s'est enfui ou s'il a été perdu de vue,
on doit connaître s'il y a de la rage ou non dans le
secteur pour décider de la conduite. Pour avoir
cette information, contacter l'ACIA au
450-476-1223 ou à défaut, la Direction de la santé
publique au 514-528-2400.
B. Animaux sauvages
La prophylaxie post exposition contre la rage est
recommandée lors d'une morsure par un animal
sauvage non disponible.
Si l'animal est disponible, contacter la santé
publique qui vous aidera à décider de la marche à
suivre et avisera l'ACIA
.
C. Morsures d'écureuil ou autres petits
rongeurs = pas de risque de rage
Une morsure d'écureuil ou d'un autre petit rongeur
ne nécessite pas l'administration d'une prophylaxie
post exposition contre la rage sauf peut-être s'il
s'agit d'une attaque apparemment sans raison faite
par un rongeur furieux et agressif.
Les morsures d’écureuils résultent souvent de la
mauvaise habitude qu’ont les gens de vouloir les
nourrir ou les caresser. Dans ces circonstances, la
morsure est considérée comme ayant été provoquée
et la PPE n’est pas indiquée.
D. Chauve-souris = risque de rage
le plus important
(consulter la Direction de la santé publique
au 514-528-2400)
Une possibilité d'exposition à une chauve-souris
doit faire l'objet d'une évaluation particulière. En
présence d’une chauve-souris, si on ne peut exclure
la possibilité qu'il y ait eu morsure ou contact de la
salive de l'animal avec une plaie ou une muqueuse
d'une personne, une PPE est indiquée. Toutefois,
le fait d’apercevoir des chauves-souris volant à
l’extérieur ou même à l’intérieur, alors qu’on ne
dort pas et qu’avec certitude on n’a pas eu de contact
direct avec celles-ci, n’est pas une situation qui
motive la vaccination.
Par contre, même en l'absence d'évidence de
morsure ou de contact, si une chauve-souris est
retrouvée à proximité d'un jeune enfant, d'une
personne endormie ou sous l'influence de l'alcool
ou de drogues, d'une personne ayant une déficience
sensorielle ou intellectuelle, la prophylaxie post
exposition contre la rage pourrait être recommandée.
La morsure de la chauve-souris étant très petite,
ces personnes pourraient avoir été mordues sans
s'en être rendu compte ni porter de marques
évidentes.
L'analyse du cerveau de l'animal serait idéale.
La DSP ou l'ACIA soupèsera la possibilité de
capturer l'animal sans risque de morsure ni de
contact cutané ou muqueux. Entre 1993 et 1997,
7% des chauves-souris analysées par qu’elles
seraient possiblement entrées en contact avec un
humain ou un animal domestique se sont avérées
rabiques. Le taux est de 1% chez les chauves-
souris choisies au hasard dans la nature.
INDICATION DE LA PROPHYLAXIE POST EXPOSITION CONTRE LA RAGE (PPE) – précisions (mai 2002)
LA PROPHYLAXIE POST EXPOSITION CONTRE LA RAGE (PPE) = LAVAGE DE LA PLAIE* + RIG* + VACCIN
Le plus tôt possible mais il n’est jamais trop tard pour l’entreprendre
•
Le lavage minutieux de la plaie avec de l'eau et du savon pendant plusieurs minutes réduirait le risque de rage de près de 90 %. Ensuite, si possible, appliquer de
l’éthanol à 70% ou de la povidone iodée (ex. : proviodine).
• Les immunoglobulines contre la rage, communément appelées RIG, à la dose de 20 UI/kg, s'administrent en même temps que la première dose de vaccin (ou
moins de 8 jours après la 1
re
dose). On infiltre la plus grande quantité possible de la dose autour et dans la plaie et on administre le reste par voie IM dans le muscle
dorso-fessier ou le vaste externe de la cuisse loin du point d’inoculation du vaccin (en utilisant une autre seringue et une autre aiguille). Si la dose calculée selon le poids
apparaît insuffisante pour infiltrer toutes les plaies, on peut diluer les RIG dans un volume de soluté physiologique équivalent au double, voire au triple de celui de la dose.
• Cinq doses de 1 ml du vaccin contre la rage échelonnées sur une période d'un mois (jours 0, 3, 7, 14, 28) doivent être administrées dans le muscle deltoïde (ou
dans le vaste externe chez le nourrisson) en respectant les intervalles.
* Particularité quand chauves-souris en cause : en l’absence d’évidence de plaie comme il arrive parfois lors d’expositions aux chauves-souris,
l’administration de la totalité des RIG se fait par voie IM dans le muscle dorso-fessier ou le vaste externe de la cuisse.
Pour plus de détails, voir le Protocole d'immunisation du Québec Note : Vérifier l'immunisation contre le tétanos.
Algorithme d’aide à la décision pour la prophylaxie post exposition contre la rage
en cas de contact avec une chauve-souris
Exposition significative
à une chauve-souris
Exposition non significative
à une chauve-souris
Exposition certaine à une chauve-souris
Morsure ou égratignure
Contact perçu de la salive de la chauve-souris
avec une plaie fraîche ou une muqueuse
1
Morsure probable (ex. : sensation douloureuse,
inconfortable ou de picotement suite à un
contact physique avec une chauve-souris; avoir
placé le doigt dans la gueule d’une chauve-
souris)
2
Exposition plausible à une chauve-souris
Un enfant a touché une chauve-souris
3
Une chauve-souris a touché la peau en plein
vol
Une chauve-souris est écrasée par un pied nu
Une chauve-souris est retrouvée dans la même
pièce qu’une personne endormie, qu’un jeune
enfant sans surveillance ou qu’une personne
avec déficience intellectuelle ou intoxiquée
(drogue, alcool)
4 et 5
Une personne dormait, à l’extérieur, à
proximité d’une chauve-souris au
comportement anormal (ex. : agressive,
difficulté à voler, paralysée)
5
Une (ou plusieurs) chauve(s)-souris vue(s) ou
entendue(s) dans les murs ou le grenier
seulement (la transmission par aérosol n’a été
prouvée que dans les grottes où il y a des
millions de chauves-souris)
Des fientes (excréments) de chauve-souris sont
retrouvées dans une ou plusieurs pièces (ex. : à
l’arrivée au chalet)
Une chauve-souris a volé à proximité d’un
adolescent ou d’un adulte qui affirme ne pas
avoir été touché
Un contact avec une carcasse de chauve-souris
complètement desséchée
Un adolescent ou un adulte fiable qui a touché à
une chauve-souris et qui est certain qu’il n’y a
eu aucune morsure ou égratignure
La prophylaxie
post exposition contre la rage (PPE)*
est recommandée
La prophylaxie
post exposition contre la rage
n’est pas recommandée
* Contacter la Direction de santé publique; elle pourra :
Aider à évaluer le niveau de risque de l’exposition lorsque nécessaire
Procéder à une enquête élargie au besoin (ex. : lorsque plusieurs personnes ont pu être exposées)
Contacter l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour l’analyse de la chauve-souris lorsque
disponible. Si le résultat de détection du virus de la rage s’avère négatif, la PPE devra être cessée.
Notes faisant partie intégrante de l’algorithme :
1. Le contact avec la fourrure d’un animal enragé n’est pas considéré comme un contact avec la salive.
2. Lorsque l’histoire peut être obtenue d’une personne fiable, les expositions suivantes ne sont pas considérées comme
des expositions significatives : manipuler à main nue (sans qu’il y ait contact avec sa gueule), flatter, manipuler sans
contact cutané, laisser l’animal se promener sur soi. Cependant, compte tenu que les blessures infligées par les
chauves-souris peuvent facilement passer inaperçues et que plusieurs cas de rage humaine sont survenus après un
contact physique sans morsure apparente, il faut être prudent et, en cas de doute, considérer qu’une morsure ou une
égratignure a pu se produire.
3. Sauf si un adulte peut confirmer par observation directe l’absence d’exposition significative (voir la note 2).
4. La prophylaxie ne serait pas indiquée pour les personnes séjournant dans les autres pièces de la maison sauf si la
chauve-souris a pu y avoir accès librement (ex. : portes ouvertes) et entrer en contact avec ces personnes. Pour celles-
ci, d’autres éléments peuvent aider à la prise de décision : le type d’habitation, le comportement et l’état de santé de
l’animal.
5. Dans ces situations où il n’y a pas de contact établi, si la chauve-souris est disponible, on devrait attendre le résultat
de détection du virus de la rage (si il peut être obtenu dans les 48 heures) avant de débuter la PPE.
MSSS 2002
Édition : Direction de la santé publique de Montréal-Centre, mai 2002
Inoffensive la chauve-souris?
Pas toujours!
Au cours des dernières décennies, la chauve-souris est le
vecteur de la rage vers l’humain le plus souvent en cause au
Canada et aux États-Unis.
Au Canada, quatre des cinq cas de rage humaine déclarés
depuis 1970 sont attribuables à une exposition à des chauves-
souris.
Aux États-Unis, depuis 1990, 24 des 32 cas de rage humaine
ont été associés à la variante du virus de la rage de la chauve-
souris.
En l’an 2000, 4 cas humains associés aux chauves-souris ont
été diagnostiqués aux États-Unis et un au Canada, plus
précisément au Québec.
Au Québec, le dernier cas survenu à l’automne 2000 a été
associé à la variante du virus de la rage de la chauve-souris
argentée.
Prévalence chez la chauve-souris
La prévalence de la rage chez les chauves-souris s’avère
stable. Moins de 1 % des chauves-souris choisies au hasard et
analysées sont rabiques. Toutefois, au Canada et au Québec,
l’infection par le virus de la rage s’élève à environ 7 % chez les
chauves-souris analysées parce qu’elles sont entrées en contact
avec des humains ou des animaux domestiques.
Rage transmise sans morsure évidente
Depuis 1990 aux États-Unis, des 24 cas de rage humaine
associés à des variantes du virus de la rage retrouvées chez les
chauves-souris, deux cas seulement présentaient une histoire de
morsure. Environ la moitié des autres cas n’avaient eu que des
contacts avec des chauves-souris et pour les autres, une
morsure non détectée et non rapportée demeure l’hypothèse la
plus probable.
Il semble que l’on n’accorde pas toujours l’attention
nécessaire aux contacts avec les chauves-souris ou que certains
contacts ne soient pas remarqués. C’est dans de telles
circonstances que le dernier cas au Québec s’est produit. Il faut
dire que les petites dents fines des chauves-souris insectivores
peuvent produire une plaie aussi inapparente que la piqûre
d’une seringue hypodermique.
Alors que la morsure d’un carnivore laisse des marques
évidentes, la morsure de la chauve-souris passe facilement
inaperçue. Malgré sa très petite taille, la chauve-souris peut
quand même transmettre la rage.
Quelques faits saillants
L’a m iantose :
des données à explorer
Le cancer du poumon :
une maladie professionelle
sous-estimée
Le mésothéliome :
des données surprenantes
1
révention
en pratique médicale
Nouvelles réalités
L’AMIANTE
Nouvelles réalités
On pourrait croire que la question des maladies de l’amiante est résolue ou à tout le moins bien documentée au Québec.
Mais détrompez-vous! Des données inexpliquées et de toutes nouvelles réalités surviennent dans le dossier de l’amiante…
Ce bulletin vous présente des outils pour vous aider à :
• Suspecter les expositions à l’amiante en dehors du secteur des mines.
• Établir une histoire professionnelle afin de documenter ces situations.
• Considérer l’amiante comme une cause possible du cancer pulmonaire de votre patient qui est un fumeur.
Le mésothéliome :
des données surprenantes
• Les grandes revues de littérature sur l’amiante
relatent que l’on retrouve une exposition à l’amiante
chez environ 80% des cas de mésothéliome. On
s’attend donc à ce que les cas de mésothéliome
d’origine professionnelle reconnus comme tels à
la CSST représentent une proportion importante
des cas diagnostiqués dans la population
générale du Québec. Or les cas vus à la CSST ne
représentent que 22% des cas de mésothéliome
diagnostiqués dans la population.
• Dans la population générale, les taux de
mésothéliome de la plèvre ont augmenté de 5%
par année entre 1982 et 1996 chez les Québécois
et de 3% par année chez les Québécoises.
Comment expliquer cette différence ? Les analyses
effectuées suggèrent que cette augmentation
pourrait être observée encore pendant plusieurs
années. Mais bien sur, ce phénomène résulte
d’une exposition passée.
• Présentement, le Québec contrôle difficilement l’ex-
position à l’amiante dans les secteurs de la con-
struction et de la transformation de l’amiante qui
génèrent un fort pourcentage des cas de
mésothéliome reconnus d’origine professionnelle à
la CSST.
• Une surveillance étroite de la situation est
nécessaire, car l’augmentation de ces cancers
pourrait persister plus longtemps que prévu.
Il faut aussi bien identifier l’exposition à
l’amiante chez les personnes souffrant de
mésothéliome, notamment en tentant de recon-
naître, au moyen d’une histoire professionnelle
poussée, des expositions en dehors du secteur
bien connu des mines.
L’amiantose :
des données à explorer
• Entre 1981 et 1996, 116 Québécois et
Québécoises sont décédés d’amiantose.
• Entre 1987 et 1996, 1 386 personnes ont été
hospitalisées au Québec avec un diagnostic prin-
cipal et secondaire d’amiantose.
• Entre 1988 et 1997, 378 travailleurs québécois ont
reçu un diagnostic d’amiantose dont l’origine pro-
fessionnelle a été reconnue. Ils proviennent prin-
cipalement du secteur de la construction et de
celui de la rénovation et de l’entretien.
• Entre 1988 et 1996, il y a presque 4 fois plus de
Québécois et de Québécoises hospitalisés une
première fois avec un diagnostic d’amiantose.
Encore une fois, quels sont les facteurs qui
expliquent une telle disparité?
Le cancer du poumon :
une maladie professionelle
sous-estimée
• Au Québec, en 1998, environ 3 500 nouveaux cas
de cancer du poumon ont été diagnostiqués chez
les hommes.
• Entre 1988 et 1997, 209 travailleurs québécois
ont eu un diagnostic de cancer du poumon relié
à l’exposition à l’amiante et reconnu
d’origine professionnelle.
• La majorité de ces travailleurs (62%) ont été
exposés à l’amiante dans les mines, contraire-
ment aux cas de mésothéliome et d’amiantose
qui proviennent principalement de la construc-
tion et de l’entretien.
• Par conséquent il y a probablement une sous-esti-
mation des cas de cancer du poumon consécutifs à
l’exposition à l’amiante dans d’autres secteurs,
notamment dans le secteur de la construction et
dans celui de la rénovation et de l’entretien. Les
209 travailleurs avec un cancer pulmonaire d’ori-
gine professionnelle ne représentent que 0,3% des
cas de cancer du poumon de la population
générale du Québec, alors qu’ils devraient
représenter entre 0,5% et 15% des cas.
Comment
expliquer cette différence?
P révention en pratique médicale, Juin 2003
Quelques faits saillants
Quoi faire en tant que médecin face à un cas ?
Maladies, diagnostic et conduite
Petit rappel sur l’amiante
Exposition à l’amiante et populations à risque
Exposition à l’amiante et populations à risque
2
Maladies, diagnostic et conduite
1. L’amiantose
L’amiantose est une fibrose interstitielle diffuse du poumon, conséquence d’une exposition antérieure à l’amiante. Le
diagnostic d’amiantose repose sur une histoire d’exposition antérieure à l’amiante ou sur la présence de fibres
d’amiante dans le tissu pulmonaire ou encore sur la présence de corps amiantosiques en excès par rapport à
la population générale.
Les symptômes sont principalement de la dyspnée et de la toux. On retrouve fréquemment des râles inspiratoires
aux bases et moins souvent du clubbing aux doigts (hippocratisme digital). Les anomalies fonctionnelles peuvent
inclure des anomalies des échanges gazeux, un syndrome restrictif et des anomalies obstructives dues à l’atteinte
des petites voies aériennes. A la radiographie, on retrouve de petites opacités 1/0 (voir la classification du Bureau
International du Travail dans la Chronique PPM intitulée :
La silicose une maladie pulmonaire du passé ? sur le
site Internet de la santé publique de Montréal). Une tomographie à haute résolution peut confirmer les images
radiologiques de l’amiantose et elle peut aussi montrer des changements précoces non vus à la radiographie.
2. Le cancer du poumon
Les signes et symptômes de cancer du poumon relié à l’exposition à l’amiante ne diffèrent pas de ceux du cancer du
poumon associé à d’autres causes. Les types histologiques ne diffèrent pas plus, ni la localisation anatomique. La
présence d’amiantose est un indicateur de forte exposition antérieure à l’amiante.
3. Le mésothéliome
Le mésothéliome de la plèvre se présente souvent par une effusion pleurale, de la dyspnée et de la douleur thoracique.
Pour faire le lien entre un mésothéliome et l’exposition à l’amiante, l’un ou l’autre des éléments suivants
devrait suffire :
• Le décompte de fibres dans les poumons dépassant le bruit de fond
• La présence radiologique ou pathologique d’amiantose
• La présence de plaques pleurales
• La présence d’anomalies histologiques comme les corps amiantosiques
En l’absence de ces éléments, une histoire d’exposition à l’amiante (professionnelle, domestique ou environ-
nementale) devrait suffire pour attribuer un cas à l’exposition.
Petit rappel sur l’amiante
Il existe deux types principaux d’amiante : les serpentines et les amphiboles.
Le Québec produit du chrysotile, une serpentine, mais il a importé des amphiboles, ce qui explique que l’on
en retrouve dans les résidences et les édifices publics construits avant la fin des années 1970 ou encore
dans les produits manufacturés par le passé.
Le risque de développer un mésothéliome varie selon le type de fibres d’amiante : il serait plus élevé suite
à l’exposition aux amphiboles.
Soyez à l’affût !
• Un patient avec une amiantose, un
mésothéliome ou un cancer du poumon a
fort probablement été exposé à l’amiante
en dehors du secteur bien connu des
mines, soit dans le secteur de la cons-
truction et dans celui de la rénovation et
de l’entretien. Penser, en tant que
médecin, à rechercher une exposition
professionnelle en dehors des mines
d’amiante !
• Un patient avec un cancer du poumon et
qui fume peut avoir été exposé à un can-
cérigène pour le poumon durant sa
carrière, notamment à l’amiante. La ci-
garette n’est peut-être pas la seule
responsable du cancer de votre patient.
• L’histoire professionnelle est donc un bon
moyen de documenter ces situations.
L’Aide-mémoire pour une histoire profes-
sionnelle peut vous aider à poser les
questions appropriées.
La prévention est de mise !
• Les maladies reliées à l’exposition à
l’amiante peuvent être prévenues puisque
l’exposition peut être évitée ou contrôlée
par :
-L’élimination du risque à la source
- Le respect des lois et règlements
existants qui visent à protéger les
travailleurs exposés
-L’identification des sources et des lieux
d’exposition à l’amiante
- L’éducation et l’information aux tra-
vailleurs, aux employeurs et aux
médecins
- La sensibilisation de la population
générale aux dangers d’être exposé à
l’amiante
• La surveillance et le suivi des sources et des
maladies reliées à l’exposition à l’amiante
deviennent plus que jamais nécessaires. En
effet, la société québécoise contrôle diffi-
cilement l’exposition actuelle à l’amiante.
Mais de plus, de futures expositions pour-
raient être générées par la Politique d’utili-
sation accrue et sécuritaire de l’amiante
chrysotile adoptée par le gouvernement du
Québec en juin 2002, si les conditions de
protection des travailleurs et de la popu-
lation n’étaient pas respectées.
Les trois principales maladies reliées à l’exposition à l’amiante sont l’amiantose, le mésothéliome et le cancer
du poumon. Elles apparaissent habituellement de 20 à 40 ans après la première exposition à l’amiante et
ces maladies présentent la caractéristique de se développer après une forte exposition à l’amiante.
Cependant le mésothéliome peut aussi apparaître après une exposition moins importante en termes de
durée et d’intensité.
Quoi faire en tant que médecin face à un cas ?
• Documenter l’exposition à l’amiante par une histoire professionnelle détaillée (voir l’Aide-mémoire pour
une histoire professionnelle).
• Donner de l’information aux patients qui sont encore exposés à l’amiante sur leur propre protection en
milieu de travail en les référant aux ressources identifiées à la dernière page.
• Informer les patients qu’ils peuvent contaminer leur famille en ramenant des vêtements et des acces-
soires contaminés par l’amiante à la maison.
P révention en pratique médicale, Juin 2003
3
Aide-mémoire pour une histoire professionnelle
AMIANTE
Aide-mémoire pour une histoire professionnelle
Pose de matériaux isolants contenant de l’amiante autour de tuyaux (calorifugeage)
Flocage d’amiante (amiante giclé ou pulvérisé sur des structures)
Démolition de vieux édifices
Rénovation de vieux édifices
Entretien, réparation de vieux édifices
Construction d’édifices ou de maisons avant 1978
Pose ou fabrication de fibro-ciment
Enlèvement d’amiante
Milieux à risque :
Raffineries
Papetières
Chantiers navals et maritimes
Chantiers ferroviaires
Édifices commerciaux
Édifices industriels
Édifices institutionnels
Mines d’amiante
Fabrication et entretien de freins
Fabrication de tuiles, de carreaux ou de bardeaux d’amiante
Fabrication de tuyaux d’amiante ciment
Fabrication de panneaux en amiante
Fabrication de portes coupe-feux contenant de l’amiante
Fabrication de papiers et cartons d’amiante
Exposition indirecte par des collègues qui travaillent avec de l’amiante
Métiers à risque :
Calorifugeur
Tuyauteur-plombier-soudeur
Tôlier-ferblantier
Manœuvre en démolition ou en enlèvement d’amiante
Électricien
Menuisier
Mécanicien d’ascenseur
Mécanicien en protection des incendies
Chaudronnier
Frigoriste
Câbleur
Poseur d’appareil de chauffage
Autres :
Activités ou opérations à risque :
• L’exposition à l’amiante responsable d’une amiantose, d’un mésothéliome ou d’un cancer du poumon remonte en général de 20 à 40 ans dans
le passé
. Il est important de penser à recueillir de l’information sur le travail de votre patient dans les métiers à risque, les milieux à risque ou
les activités et opérations à risque actuels et passés.
•
La durée de l’exposition à l’amiante est aussi importante à documenter puisque la probabilité de développer l’une ou l’autre de ces maladies aug-
mente avec l’exposition.
• Ne pas oublier que les premières
manifestations radiologiques de l’amiantose sont rarement visibles avant 15 ans depuis l’année de la première
exposition à l’amiante.
De (année)
Durée
À (année)
P révention en pratique médicale, Juin 2003
Organismes et fonctions
Grandes revues de littérature :
• Health Effects Institute-Asbestos Research. Asbestos in
public and commercial buildings: a literature review and
synthesis of current knowledge - Final report. Cambridge:
Health Effects Institute - Asbestos Research; 1991.
• INSERM. Effets sur la santé des principaux types d’exposition
à l’amiante. Paris: Les Éditions INSERM; 1997.
Rapport de consensus :
• Consensus report. Asbestos, asbestosis, and cancer : the
Helsinki criteria for diagnosis and attribution. Scand J Work
Environ Health 1997; 23 : 311-6.
Aspects cliniques :
• Newman LS. Occupational illness. New Engl J Med 1995 ;
333(17) : 1128-34.
• Gauthier JJ, Ostiguy G, Malo JL, Cormier Y. Maladies
pulmonaires professionnelles et environnementales.
In : Gauthier JJ, Bolduc P, Cormier Y, Nadeau P, eds.
Pneumologie clinique. Montréal: Les Presses de l’Université
de Montréal; 2002. P. 575-607.
• Guidelines for use of ILO international classification of
radiographs of pneumoconioses, revised edition 1980.
Occupational safety and health series, no.22, International
Labour Office, Geneva 1980.
• Chronique Prévention en pratique médicale sur la silicose sur
le site Internet de la santé publique à l’adresse suivante :
www.santepub-mtl.qc.ca.
Aspects épidémiologiques :
• Épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante
au Québec. Rapport du Sous-comité sur l’épidémiologie des
maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec du
Comité aviseur sur l’amiante au Québec et présenté au
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec.
Septembre 2002.
Pour en savoir plus
révention
en pratique médicale
4
www.santepub-mtl.qc.ca
révention
en pratique médicale
C’est aussi une chronique bimensuelle Internet
• Les inspecteurs de la Commission de la santé et de la sécu-
rité du travail (CSST) mènent des enquêtes suite à des
plaintes. Tél : (514) 906-2911 (24 heures).
• Les équipes de santé au travail des CLSC désignés par la
CSST effectuent un suivi médico-environnemental dans les
milieux de travail.
• L’équipe de Santé au travail et environnementale de la
Direction de santé publique de Montréal-Centre.
Tél : (514) 528-2400.
• La Clinique interuniversitaire de santé au travail et santé
environnementale offre des services de consultation et de
suivi post-exposition sur référence du médecin traitant.
Tél : (514) 843-2080.
Ressources
P révention en pratique médicale, Juin 2003
Un bulletin de la Direction de la santé publique
de Montréal-Centre publié avec la collaboration
de l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal
dans le cadre du programme Prévention en pratique médicale
coordonné par le docteur Jean Cloutier.
Ce numéro est une réalisation de l’unité
Santé au travail et Santé environnementale.
Responsable de l’unité : D
r
Louis Drouin
Rédacteur en chef : D
r
Louis Patry
Édition : Anne Marie Comparot
Infographie : Manon Girard
Rédacteurs : D
r
Louise De Guire
Collaborateurs : D
r
Monique Letellier,
D
r
Jean-Pierre Villeneuve
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1M3
Téléphone : (514) 528-2400
Dépôt légal – 2
e
trimestre 2003
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1481-3734
Numéro de convention : 1455958
Association
des Médecins
Omnipraticiens
de Montréal
La campagne de sensibilisation
La campagne de sensibilisation
La campagne « Prudence avec le sang », lancée en février 2003 par
la Direction de santé publique de Montréal-Centre, a été conçue pour
rejoindre ces travailleurs et leurs employeurs afin de prévenir les
accidents impliquant une exposition au sang en milieu de travail.
Une pochette contenant de nombreuses informations sur les risques
d’infection suite à un contact avec le sang, sur les méthodes sécuri-
taires de travail et sur les gestes à poser suite à une exposition est
maintenant disponible pour tous les employeurs et les travailleurs
concernés.
Dans cette pochette, on retrouve :
• Un dépliant d’information à l’intention des travailleurs
• Un dépliant à l’intention des employeurs
• Une affiche «Danger avec le sang»
• La carte des CLSC en santé au travail
• Un bon de commande
• 8 affichettes :
- Le lavage des mains
- L’entretien ménager
- La manipulation des ordures
- La manipulation de la literie
- La manipulation des objets coupants,
piquants ou tranchants
- Secours à une personne blessée
- Contact accidentel avec du sang
- Aide mémoire aux gestionnaires
Cette pochette a été diffusée à l’ensemble des hôtels, des restaurants
et des commerces de la région de Montréal. Vous pouvez, en tant que
médecin, vous en procurer pour vos patients qui pourraient béné-
ficier de ces informations.
Ces outils de sensibilisation sont disponibles
à la Direction de santé publique de Montréal-Centre
en remplissant le bon de commande sur le site Internet :
www.santepub-mtl.qc.ca/Travail/risquebio/sang/index.html
Auteure : Michèle Dupont, M.D., M.Sc., médecin-conseil
Unité santé au travail et environnementale
Direction de santé publique de Montréal-Centre
Des outils pour informer vos patients
LA CAMPAGNE « PRUDENCE AVEC LE SANG » :
Des outils pour informer vos patients
En milieu de travail, certaines
situations peuvent exposer les
travailleurs à du sang contaminé
par des agents pathogènes
comme les virus de l’hépatite B et
de l’hépatite C ainsi qu’au VIH.
L’ensemble des travailleurs de la
santé, les policiers, les pompiers,
les agents de services correction-
nels et les secouristes sont ren-
seignés sur les mesures à prendre
pour se protéger.
Pourtant d’autres secteurs sont moins bien informés. Les statistiques
du Centre régional de prophylaxie post-exposition de Montréal, qui
se spécialise dans les soins aux personnes exposées accidentellement
au sang et autres liquides biologiques, démontrent qu’entre mars
1999 et mars 2003, 1 786 personnes ont été évaluées pour une expo-
sition s’étant produite en milieu de travail. De ce nombre environ
300 travailleurs provenaient des secteurs d’activités suivants :
hôtels, restaurants, commerces et autres services.
Ces accidents
impliquant un contact avec le sang peuvent survenir que se soit :
• À l’hôtel en nettoyant une salle de bain
• Chez le nettoyeur en manipulant des
vêtements imbibés de sang
• Dans un parc en taillant un arbuste
• Dans un club de golf en nettoyant une
voiturette
• Dans une station-service en vidant une
poubelle
• Dans un restaurant en nettoyant les
toilettes
Ainsi, les expositions accidentelles avec le sang peuvent survenir en
milieu de travail, par une piqûre avec des seringues à la traîne, par
une coupure avec des objets coupants-tranchants, en portant
secours à des clients ou à des collègues de travail. Les travailleurs
doivent donc être informés des risques, des mesures de prévention à
utiliser et des gestes à poser suite à une exposition au sang et autres
liquides biologiques.
P révention en pratique médicale, Juin 2003
révention
en pratique médicale
1
Juin 2004
Pathologies thermiques
Coup de chaleur
• Forme d’hyperthermie (température
interne habituellement en haut de 41 °C)
associée avec une «dysfonction de mul-
tiples organes » où l’encéphalopathie
prédomine.
• Se présente soudainement, par un delirium
ou un coma; seulement 20 % des patients
ont des symptômes prodromiques.
• Urgence médicale, létalité de 40 %
Épuisement à la chaleur
• Moins sévère que le coup de chaleur
(température corporelle rarement
supérieure à 38,9 °C)
• Cause étourdissements, faiblesses et
fatigue, sans atteinte des fonctions men-
tales supérieures
• Résulte d’un mauvais remplacement des
réserves d’eau et de sels, après plusieurs
jours d’exposition à la chaleur.
Syncope de chaleur
• Perte de conscience transitoire
• Résulte d’une baisse du débit sanguin au
cerveau
• Vue chez les personnes qui font une acti-
vité physique et chez les personnes âgées
Crampes de chaleur
• Crampes musculaires, brèves, intermit-
tentes et souvent sévères
• Surviennent pendant ou peu de temps
après un exercice physique
• Semblent résulter d’un déséquilibre élec-
trolytique transitoire
Chaleur accablante
« Docteur, il fait chaud pour mourir! »
Les effets de la canicule sur la santé ne
doivent pas être sous-estimés! En Europe,
l’été dernier, les autorités de santé
publique ont estimé que la canicule qui
a sévi en août a causé 21 000 décès. De ce
nombre, 15 000 ont été enregistrés en
France dont 1 154 dans la seule région
de Paris. Or, du 4 au 12 août 2003, la
température maximale à Paris s’est
maintenue au-dessus de 35 °C. Les nuits des 11 et 12 août, le mercure
n’est pas descendu sous 25 °C, ce qui a exacerbé le problème.
Le nombre de décès augmente lorsque l’indice Humidex se situe entre 30 et
39. À Toronto, une étude rétrospective a démontré qu’un excès de 3,5 décès
par jour survient lorsque l’indice Humidex atteint entre 40 et 45.
Qu’est-ce qu’une vague
de chaleur?
Au Canada, on utilise l’indice Humidex pour
exprimer l’effet combiné de la chaleur et de
l’humidité. Un indice Humidex de 30 à 39 est
associé à un degré variable d’inconfort, alors
qu’à partir d’un indice de 40, presque
toutes les personnes sont inconfortables.
Environnement Canada émet un avertis-
sement de chaleur lorsque la température
ambiante atteint 30 °C et que l’indice
Humidex est de 40. Bien qu’il n’existe pas
de véritable définition d’une vague de
chaleur, elle désigne généralement une
période d’au moins trois jours consécutifs où
la température de l’air est supérieure à 32 °C.
Quels sont les effets de
la chaleur sur la santé?
Une chaleur excessive peut causer divers
effets sur la santé de gravité variable :
déshydratation, fatigue, crampes, syncope,
épuisement et coup de chaleur.
Plus inquiétant toutefois, en termes du
nombre de personnes affectées, la chaleur
accablante entraîne des décès préma-
turés de personnes souffrant de maladies
chroniques. En fait, des études épidémio-
logiques révèlent que la majorité des
décès associés à la chaleur ne présentent
pas les signes classiques de pathologie
thermique.
« Docteur, il fait chaud pour mourir! »
Qu’est-ce qu’une vague
de chaleur?
Quels sont les effets de
la chaleur sur la santé?
Pathologies thermiques
2
Pré vention en pratique mé dicale, Juin 2004
Caractéristiques d’une
vague de chaleur
dangereuse
• Canicule survenant tôt dans l’été alors
que le corps n’est pas encore acclimaté à
la chaleur. En fin de saison, la canicule
présente un risque moindre.
• Vague de chaleur soudaine, surtout si
elle suit une période de temps frais, car
l’acclimatation ne peut se faire graduel-
lement.
• Canicule durant laquelle la chaleur per-
siste même la nuit, n’offrant ainsi aucun
répit pour le corps.
• Vague de chaleur associée à une forte
pollution (épisode de smog).
La réponse
physiologique
Pour arriver à maintenir une température
corporelle normale, les mécanismes de la
thermorégulation, soit principalement la
vasodilatation cutanée et la sudation, sont
stimulés par l’hypothalamus en réaction à
la détection d’une température interne qui
s’élève.
En effet, en augmentant la circulation
périphérique atteignant la peau, le corps
expose un plus haut débit de sang à la
thermolyse. Cette vasodilatation péri-
phérique est essentielle à la sudation, qui
augmentera la thermolyse par évapora-
tion. Par temps chaud, l’évaporation
devient le mécanisme principal pour
assurer la dissipation de la chaleur cor-
porelle; elle est alors responsable de 75 %
de la thermolyse. Le débit normal de
sudation est de 500 ml/24 heures. Elle
contient environ 40 mmol/l de sodium,
7 mmol/l de potassium et 35 mmol/l de
chlore. Dans des conditions extrêmes, le
débit peut atteindre 1 litre d’eau par heure.
Parmi les autres mécanismes impliqués
dans la thermorégulation, mentionnons la
sécrétion d’hormone anti-diurétique et
d’aldostérone ainsi que l’augmentation
des rythmes cardiaque et respiratoire.
L’adaptation à la chaleur survient lorsque
l’exposition se prolonge. En plus de mieux
supporter la chaleur (tolérance psycho-
logique), une tolérance physiologique s’ins-
talle. Elle apparaît après quelques jours
(environ 1 semaine) d’exposition à des
températures chaudes et elle disparaît
plusieurs semaines après l’arrêt de l’expo-
sition. Cette adaptation se caractérise par
une augmentation de l’efficacité de la
sudation (plus précoce, plus abondante,
avec une concentration réduite en sels) et
une vasodilatation cutanée plus précoce
dans certaines parties du corps.
Quels sont les facteurs
de risque?
Un environnement chaud : Vivre dans
un milieu non climatisé, ou au dernier
étage d’un bâtiment, sans accès à une
zone fraîche pendant la journée, est lié à
une augmentation de la mortalité par
temps chaud.
Une réponse physiologique limitée :
Plusieurs maladies peuvent limiter la
capacité du corps à supporter le stress
thermique. Certaines agissent en réduisant
l’efficacité de la thermorégulation,
comme l’atteinte du système nerveux
autonome associée au diabète. D’autres
maladies sont à risque de décompenser
suite à la réponse à la chaleur. Ainsi, la
vasodilatation périphérique se fait au
dépend du débit cardiaque, qui doit dou-
bler ou même quadrupler.
Pratique d’activité physique : Certains
travailleurs, militaires et athlètes sont parti-
culièrement à risque de pathologie ther-
mique, malgré qu’ils soient jeunes et en
santé. Chez une personne pratiquant une
activité physique intense sous la chaleur, la
présence d’obésité, de maladie fébrile ou
de diarrhée augmente le risque d’être vic-
time d’un coup de chaleur.
Capacité limitée de se protéger : Les per-
sonnes présentant une perte d’autonomie
peuvent avoir des difficultés à prendre soin
d’elle-même, à s’hydrater ou à se rendre
dans des zones fraîches. Certaines mala-
dies psychiatriques pourraient entraîner des
patients à adopter des comportements inap-
propriés en période de chaleur accablante.
Pourquoi les personnes
âgées sont-elles parti-
culièrement à risque?
En plus des limitations liées aux maladies
chroniques, à la perte d’autonomie et aux
médicaments, les personnes âgées présen-
tent une capacité réduite d’adaptation à la
chaleur caractérisée par : une réduction de
la perception de la chaleur, une fibrose des
glandes sudoripares et une diminution de la
capacité de vasodilatation du système
capillaire sous-cutané.
MÉCANISMES D’ÉCHANGES DE CHALEUR
Le corps génère lui-même de la chaleur par ses activités métaboliques. Les transferts
de chaleur entre le corps et l’environnement se font par quatre mécanismes.
Nom
Conduction
Convection
Radiation
Évaporation
Mécanisme de l’échange thermique
Transfert d’énergie d’un objet plus
chaud vers un objet plus froid
Circulation d’air ou de vapeur d’eau
autour du corps
Ondes électromagnétiques (comme la
radiation solaire ou celle d’un four)
Lorsque l’eau contenue dans la sueur
(et accessoirement dans les voies res-
piratoires) passe de la phase liquide à
la phase gazeuse
Exemple
Se plonger dans l’eau fraîche
S’asseoir face à un ventilateur.
Il faut cependant se méfier des
ventilateurs si aucune fenêtre
n’est ouverte pour permettre
un apport d’air frais.
Un gain important de chaleur
si on s’expose au soleil.
L’évaporation est maximisée
dans un environnement sec et
chaud, ainsi que par le vent.
Caractéristiques d’une
vague de chaleur
dangereuse
La réponse
physiologique
Quels sont les facteurs
de risque?
Pourquoi les personnes
âgées sont-elles parti-
culièrement à risque?
3
Pré vention en pratique mé dicale, Juin 2004
Prise en charge des
patients par le médecin
Étape 1 • Identifier la clientèle à risque
Qui est à risque?
• Personnes âgées
• Personnes souffrant d’une maladie
chronique
• Nourrissons et enfants en bas âge
• Itinérants/sans abri
• Travailleurs en ambiance chaude
Facteurs d’aggravation
• Absence de climatisation
• Isolement social ou perte d’autonomie
• Pauvreté
• Consommation d’alcool ou de drogues
• Activité physique intense
• Médication
plusieurs classes de médicaments ont des
interactions avec la réponse à la chaleur.
L’évaluation des risques et des bénéfices
devrait alors être faite pour chaque patient.
En premier lieu, il est toujours important
de s’assurer que les conseils aux patients,
concernant l’environnement et l’hydrata-
tion, soient bien respectés. Avant de modi-
fier la médication, il importe d’évaluer
l’état d’hydratation du patient (apports
hydriques, poids, rythme cardiaque, ten-
sion artérielle) et de compléter au besoin
avec un dosage des électrolytes et une
évaluation de la clairance de la créatinine.
Attention aux AINS qui sont particulière-
ment néphrotoxiques pour les patients
déshydratés et à l’acétaminophène en cas
de fièvre, en raison de son inefficacité pour
traiter le coup de chaleur et d’une possible
aggravation d’une atteinte hépatique.
De la même manière, il importe d’évaluer
la restriction hydro sodée prescrite aux
patients, en fonction de l’état de chacun.
Maladies chroniques et pathologies met-
tant les patients à risque lors d’épisodes
de chaleur
• Cardiovasculaires : athérosclérose, HTA
non contrôlée, insuffisance cardiaque, patho-
logie vasculaire périphérique ou cérébrale
• Neurologiques : maladie de Parkinson,
maladie d’Alzheimer et maladies appa-
rentées, anomalie du système nerveux
autonome
• Endocriniennes : diabète, hyperthyroïdie
• Maladies psychiatriques
• Autres : insuffisance respiratoire, insuffi-
sance rénale, obésité, infection, trouble
de l’alimentation, déshydratation, lésions
étendues de la peau, anémie falciforme,
fibrose kystique
Étape 2 • Ajuster les traitements
Pendant une vague de chaleur, il pourrait
être nécessaire de revoir la médication de
certains patients. En soit, la chaleur n’est
pas une contre-indication absolue, mais,
comme le montre le tableau ci-dessous,
MISE EN GARDE SUR LA MÉDICATION
MÉDICAMENTS SUSCEPTIBLES D’AGGRAVER LE SYNDROME D’ÉPUISEMENT-DÉSHYDRATATION ET LE COUP DE CHALEUR
Médicaments provoquant des troubles de Diurétiques, en particulier les diurétiques de l’anse (furosémide)
l’hydratation et des troubles électrolytiques
Médicaments susceptibles d’altérer
AINS (comprenant les salicylés > 500 mg/j, les AINS classiques et
la fonction rénale les inhibiteurs sélectifs de la COX-2)
IECA
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II
Sulfamides
Indinavir
Médicaments ayant un profil cinétique Sels de lithium
pouvant être affecté par la déshydratation Anti-arythmiques
Digoxine
Anti-épileptiques
Biguanides et sulfamides hypoglycémiants
Statines et fibrates
Médicaments pouvant empêcher la perte calorique
• Au niveau central Neuroleptiques
Agonistes sérotoninergiques
• Au niveau périphérique Médicaments anticholinergiques
(par limitation de la sudation)
Vasoconstricteurs
Médicaments diminuant
le débit cardiaque
• Par modification du Hormones thyroïdiennes
métabolisme basal
MÉDICAMENTS HYPERTHERMISANTS (dans des conditions normales de température ou en cas de vague de chaleur)
Neuroleptiques
Agonistes sérotoninergiques
MÉDICAMENTS POUVANT AGGRAVER LES EFFETS DE LA CHALEUR
Médicaments pouvant abaisser Tous les antihypertenseurs
la pression artérielle Les anti-angineux
Médicaments altérant la vigilance
- antidépresseurs tricycliques
- antihistaminiques de première génération
- certains antiparkinsoniens
- certains antispasmodiques, en particulier ceux de la sphère urinaire
- neuroleptiques
- disopyramide
- pizotifène
- agonistes et amines sympathomimétiques
- certains antimigraineux (dérivés de l’ergot de seigle, triptans)
- bêta-bloquants
- diurétiques
Source : Ministère de la Santé et de la Protection sociale et ministère délégué aux Personnes âgées, Plan National Canicule, Annexe 7 : Recommandations en cas de
fortes chaleurs, fiche 4.4 Médicaments et chaleur, p.149, mai 2004 • www.sante.gouv.fr (cliquez sur canicule et chaleurs extrêmes.)
Prise en charge des
patients par le médecin
Association
des Médecins
Omnipraticiens
de Montréal
Un bulletin de la Direction de santé publique
de Montréal publié avec la collaboration de
l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal
dans le cadre du programme Prévention en pratique médicale
coordonné par le docteur Jean Cloutier.
Ce numéro est une réalisation de l’unité Santé au travail
et santé environnementale.
Responsable d’unité : D
r
Louis Drouin
Rédacteur en chef : D
r
Louis Patry
Édition : Deborah Bonney
Infographie : Julie Milette
Auteures : D
r
Nathalie Auger, D
r
Stéfanie Houde
Collaborateur : D
r
Louis Jacques
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2L 1M3
Téléphone : (514) 528-2400
courriel:
ISSN : 1481-3734
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2004
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada, 2004
Numéro de convention : 40005583
révention
en pratique médicale
4
Prévention en pratique médicale, Juin 2004
Étape 3 • Conseiller vos patients
Des mesures simples peuvent aider le
corps à bien tolérer la chaleur. Il est impor-
tant que vos patients sachent quoi faire
lorsqu’il fait chaud.
• Éviter la chaleur en optant pour un envi-
ronnement climatisé. Pour ceux qui ne
peuvent climatiser leur logement, des
visites fréquentes à la piscine ou aux
endroits climatisés comme les centres
commerciaux, les cinémas et les édifices
communautaires sont souhaitables. Un
repos de quelques heures par jour dans
un endroit climatisé est une mesure effi-
cace pour réduire la mortalité et la mor-
bidité liées à la chaleur.
• Les fenêtres devraient être fermées tant
que la température intérieure est
inférieure à la température extérieure.
Ainsi, elles devraient être ouvertes,
surtout la nuit, si la résidence n’est pas
climatisée. Sachez que le patient pourrait
ne pas le faire par crainte des intrus.
• Se méfier de l’usage des ventilateurs : ils
apportent un certain confort que si une
fenêtre ouverte permet de rafraîchir l’air.
De plus, ils n’ont pas été démontrés effi-
caces pour réduire la morbidité ou la
mortalité due à la chaleur.
• Fermer les rideaux et les volets des
fenêtres exposées au soleil.
• Bien s’hydrater : boire plus qu’à l’ordi-
naire et éviter l’alcool. Il est important
de boire avant d’avoir soif, car lorsqu’on
ressent la soif, la perte liquidienne est
déjà d’environ 1 litre pour une personne
de 70 kg. Il faut également consommer
des aliments pour remplacer les sels. La
consommation de liquides est facilitée
s’ils sont frais et légèrement sucrés; mais
il faut se méfier des boissons commer-
ciales, souvent trop sucrées.
• Porter des vêtements légers, amples et
pâles.
• Prendre des douches et des bains frais
aussi souvent que nécessaire.
• Réduire au minimum les activités
physiques et reporter les activités en
plein air aux périodes les plus fraîches
de la journée.
• Veiller à ne pas laisser des enfants seuls
dans un endroit fermé, comme un
véhicule.
• Identifier des proches ou des ressources
communautaires qui pourront les contacter
pendant une période de canicule pour
s’assurer que leur état de santé se maintient.
Vous pouvez remettre à vos patients le
dépliant « Quand il fait chaud pour mourir
Prudence! ». Si vous désirez d’autres exem-
plaires, veuillez contacter Maryse Arpin au
514-528-2400 poste 3257. Un dépliant
spécialement conçu pour les travailleurs
« Attention au coup de chaleur » est aussi
disponible à la CSST (www.csst.qc.ca)
Conclusion
Le médecin, en synergie avec les interven-
tions de santé publique, peut prévenir des
problèmes de santé et des décès dus à
la chaleur. Par des interventions et des
conseils judicieux sur les mesures à pren-
dre en cas de vague de chaleur, il renforce
et personnalise les messages diffusés à
toute la population. Dans le cas d’une
vague de chaleur grave, un plan de
mesures d’urgence sera déployé par la
DSP, les autorités municipales et la sécu-
rité civile, plan au quel les médecins seront
invités à prendre part.
Conclusion
Le programme québécois de dépistage du cancer du sein
Une solution optimiste pour un sujet anxiogène
Des statistiques
encourageantes!
Selon le rapport « Statistiques cana-
diennes sur le cancer 2005 » publié
par l’Institut National du Cancer du
Canada depuis 1993, les taux d’inci-
dence réels du cancer du sein se sont
stabilisés, et les taux de mortalité
due au cancer du sein ont diminué
continuellement.
De fait, les données réelles les plus
récentes de 2001 indiquent que le
taux de mortalité par cancer du sein
n’a jamais été aussi bas depuis 1950.
Une tendance à la baisse similaire
s’observe aux États-Unis, au Royaume-
Uni et en Australie. Des données font
ressortir une amélioration de la survie
attribuable à la fois aux programmes
organisés de dépistage par mammo-
graphie et aux traitements adjuvants
à la suite d’une chirurgie pour un
cancer du sein.
Prévention et dépistage
Le cancer du sein ne bénéficie actuel-
lement d’aucun mode de prévention
valable. Au Québec, il reste le cancer
le plus fréquent chez la femme avec
6 000 nouveaux cas par an, entraînant
chaque année 1 400 décès.
On constate néanmoins qu’au fil
des ans, le dépistage systématique
du cancer du sein basé sur l’examen
médical clinique annuel des seins et
la mammographie de dépistage aux
deux ans pour les femmes âgées de
50 à 69 ans telle que prescrite par le
Programme québécois de dépistage
du cancer du sein (PQDCS), a fait ses
preuves dans plusieurs pays.
Les bénéfices d’un programme de
dépistage systématique du cancer du
sein sont importants et très gratifiants :
des lésions dépistées et diagnostiquées
à des stades de plus en plus précoces,
parfois microscopiques, des traite-
ments chirurgicaux qui préservent
l’anatomie mammaire, minimisant
ainsi l’atteinte corporelle et surtout
une survie considérablement amélio-
rée, atteignant jusqu’à 99% à cinq ans
pour les lésions non invasives.
L’auto-examen mensuel des seins
est toujours conseillé aux femmes
mais n’est plus considéré comme
partie intégrante d’un programme
de dépistage.
L’importance pour les femmes
de se prendre en mains!
Deux situations doivent inciter les
femmes à consulter le plus tôt possible,
quelque soit leur âge :
�
lorsqu’elles observent la présence
d’un nodule inhabituel, récent et
dur au niveau d’un sein ou
�
lorsqu’elles savent que plusieurs
membres de la famille (tantes, mère
et/ou sœurs) ont été ou sont atteintes
d’un cancer du sein surtout lorsqu’il
y a, de plus, association de cancers
ovariens.
Au Québec, la mammographie de
dépistage est accessible gratuitement
à toute femme âgée de 40 ans à 49
J u i n 2 0 0 6
révention
en pratique médicale
ans chez qui le médecin reconnaît la
pertinence d’un tel examen et fournit
une prescription à cet effet à cause de
la présence de facteurs de risque de
cancer du sein et de conditions parti-
culières pouvant avoir un lien avec le
cancer du sein. Lorsque le dépistage
par mammographie est indiqué chez
une femme de moins de 50 ans, l’exa-
men peut être répété dans un intervalle
plus court que deux ans (l’intervalle
optimal est laissé au jugement du
médecin traitant).
De fait, les données réelles
les plus récentes de 2001
indiquent que le taux de
mortalité par cancer du sein
n’a jamais été aussi bas
depuis 1950.
1
Au Québec, depuis 1998, le PQDCS est offert aux femmes âgées de 50 à 69 ans qui ne présentent aucune
symptomatologie au niveau mammaire. Ces femmes peuvent participer au Programme sur simple pres-
cription de leur médecin ou sur invitation par lettre du Directeur de la Santé Publique de la région où
elles habitent. Elles n’ont alors qu’à se présenter à l’un des Centres de Dépistage Désignés (CDD) dont
elles obtiendront facilement la liste en s’adressant au bureau de la direction de santé publique de leur
région. Advenant une mammographie anormale, des examens complémentaires seront faits et, le cas
échéant, certaines femmes seront dirigées vers des Centres de Référence pour investigation et diagnostic
(CRID).
Plusieurs études confirment que le facteur le plus important qui motive la participation à un programme
de dépistage est la suggestion du médecin, en particulier celle de l’omnipraticien, qui devient l’artisan
principal du succès de tout programme de dépistage :
�
en expliquant à la femme l’importance du dépistage du cancer du sein par mammographie, les éléments
du Programme québécois du dépistage du cancer du sein (PQDCS) et l’importance d’apporter, lors de
leur rendez-vous, les films des examens antérieurs
�
en lui prescrivant à tous les deux ans une mammographie de dépistage
�
en la référant à un centre de dépistage désigné (CDD) ou à un centre de référence pour investigation
désigné (CRID) selon les suggestions des examens complémentaires du radiologue
�
en procédant au moins une fois l’an à un examen clinique minutieux des seins
�
en référant la femme à un centre de dépistage désigné (CDD) par le PQDCS pour cet examen de
dépistage
�
en présence de signes cliniques, en prescrivant une mam-
mographie de diagnostic
�
en prenant connaissance des rapports de mammographie
et en expliquant à la femme ayant un examen anormal la
nature des résultats de son examen
�
en assurant le suivi auprès des femmes ayant une mam-
mographie anormale, et prescrivant, selon l’évaluation
clinique, les examens complémentaires suggérés par le
radiologiste si cela n’a pas été fait par ce dernier
�
en collaborant ou communiquant, au besoin pour toute
question ou suggestion, avec le Centre de coordination
régional (CCR) du PQDCS
Une participation au Programme de 70 % des femmes âgées de 50 à 69 ans pourrait apporter une
diminution notable de la mortalité par cancer du sein d’ici les 10 prochaines années.
P r é v e n t i o n e n p r a t i q u e m é d i c a l e , J u i n 2 0 0 6
La participation au Programme Québécois de Dépistage
du Cancer du Sein (PQDCS)
Une nécessité pour les femmes âgées de 50 à 69 ans !
Les femmes ainsi que les médecins
en général ont donc un rôle primor-
dial à jouer dans l’atteinte de ces
objectifs; les femmes en s’inscrivant
massivement à ce programme et les
médecins en incitant leurs patientes
à y participer, en les dirigeant dans
le réseau du PQDCS et en assumant
un suivi adéquat.
2
P r é v e n t i o n e n p r a t i q u e m é d i c a l e , J u i n 2 0 0 6
3
Mammographie de dépistage
dans le cadre du PQDCS
�
Offerte à toute femme asymptomatique
de 50 à 69 ans
�
Sur prescription médicale ou
par lettre d’invitation du DSP
�
Relance et rappel aux deux ans
des femmes admissibles
�
Transmission des résultats :
- directement au médecin
dans les 10 jours si le résultat est normal,
ou dans les 5 jours si le résultat est anormal
- à la femme
dans les 10 jours par le biais du CCR
Mammographie de dépistage
hors-programme
�
Accessible :
- aux femmes de 40 à 49 ans
ayant une histoire familiale pertinente
- aux femmes de 70 ans et plus
selon leur état de santé général
- aux femmes de 50 à 69 ans
ayant refusé d’adhérer au programme lors
d’une première invitation
�
Sur prescription médicale seulement
�
Résultats envoyés au médecin seulement,
selon la pratrique courante
*(1) Pour les femmes de moins de 49 ans,
des situations exceptionnelles peuvent demander
une surveillance accrue par le biais
de mammographies diagnostiques :
�
irradiations pour une maladie de Hodgkin
�
histoire familiale suggérant une possibilité de
transmission héréditaire (4 personnes ou plus)
�
histoire personnelle d’hyperplasie atypique, de
carcinome lobulaire in situ ou de cancer du sein
�
Le cancer le plus fréquent chez la femme après celui de la peau
�
La deuxième cause de décès par cancer chez la femme après le
poumon
�
Les principaux facteurs de risque : l’âge et l’histoire familiale de
cancer du sein
�
La mammographie périodique chez les femmes de 50 à 69 ans est
présentement la seule méthode de dépistage reconnue efficace pour
diminuer la mortalité par cancer du sein
�
Le dépistage systématique est controversé pour les femmes de 40
à 49 ans
L’objectif :
�
Réduire de 24 % la mortalité par cancer du sein d’ici l’an 2008 dans
la clientèle-cible
Les services :
�
Lettres d’invitation du directeur de santé publique (DSP) pour aller
passer une mammographie de dépistage et rappel aux deux ans pour
la population admissible
�
Recueil et transmission des données supportés par un système
informatique
�
Soutien aux femmes en attente de diagnostic
La clientèle-cible :
�
Femmes asymptomatiques de 50 à 69 ans
La structure :
Mise en place d’un réseau soumis à des normes de qualité et d’éva-
luation continue comprenant :
�
un centre de coordination régional (CCR)
�
des centres de dépistage désignés (CDD)
�
des centres de référence pour investigation et diagnostic (CRID)
Le programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS)
La problématique
Le dépistage par mammographie
�
Les mammographies de dépistage, qu’elles soient demandées ou non dans le cadre du PQDCS, seront couvertes une fois aux deux ans par
la RAMQ, seulement si elles sont effectuées dans les CDD.
Dépistage et investigation par mammographie
avec signes ou symptômes
FEMME
sans signe ou symptôme
< 40 ans
PAS DE DÉPISTAGE*(1)
INVESTIGATION
Mammographie diagnostique
�
En clinique radiologique ou
en centre hospitalier
�
Investigation, traitement, suivi et transmission
des données selon la pratique courante
Cancer du sein
DÉPISTAGE
avec histoire familiale
(soeur ou mère attein-
te d’un cancer du sein
avant la ménopause)
40-49 ans 50-69 ans > 70 ans
quel que soit l’âge
sans histoire
familliale
Un bulletin de la Direction de santé publique
de Montréal publié avec la collaboration de
l’ Association des médecins omnipraticiens de Montréal
dans le cadre du programme Prévention en pratique
médicale, Volet Information, coordonné par
le docteur Jean Cloutier.
Ce numéro est une réalisation du secteur
Services préventifs en milieux cliniques
Responsable du secteur : D
r
Jacques Durocher
Édition : Élisabeth Pérès
Infographie : Paul Cloutier
Auteur : D
r
Pierre Audet-Lapointe
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)
H2L 1M3
Téléphone : (514) 528-2400
courriel:
ISSN (version imprimée) : 1481-3734
ISSN (version en ligne) : 1712-2937
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2006
Bibliothèque et Archives Canada, 2006
Numéro de convention : 40005583
révention
en pratique médicale
Association
des Médecins
Omnipraticiens
de Montréal
4
P r é v e n t i o n e n p r a t i q u e m é d i c a l e , J u i n 2 0 0 6
L’objectif de ce DVD est de rendre
accessible, à toutes les Québécoises,
l’information sur le dépistage du can-
cer du sein en prenant en considéra-
Un cédérom sur le cancer qui propo-
se une revue de littérature mondiale
sur le cancer du sein et met l’accent
sur la mammographie, des mises en
situation cliniques et radiologiques
permettant de recréer une pratique
médicale virtuelle. Un document
qui :
�
présente une approche multidisci-
plinaire
�
est le fruit du travail de nombreux
spécialistes internationaux
�
est rédigé en français et en anglais
�
est agréé par le Collège royal
des médecins et chirurgiens du
Canada
�
constitue un module d’autoforma-
tion et d’autoévaluation quelque
soit votre spécialité
Il est possible d’acheter ou d’emprun-
ter ce DVD à la Société canadienne du
cancer au 1 888 939-3333. D’autres
organismes permettent l’emprunt
tels : la Fondation du cancer du sein
du Québec au 1 877 990-7171, la
Fondation québécoise du cancer au
1 800 363-0063 ou une des biblio-
thèques de la Ville de Montréal. De
plus, plusieurs CLSC et organismes
communautaires en auront à leur
disposition. De l’animation gratuite,
en lien avec le DVD, est également
offerte dans la région de Montréal par
la Table d’information sur la santé des
femmes et le dépistage du cancer du
sein de Relais-femmes 514 878-1212
poste 212.
Le DVD « Autour des seins » : une première au Québec
tion leurs diverses réalités. Le DVD
peut se visionner en français, anglais,
espagnol, italien, arabe, mandarin et
cantonnais. Il est également en langues
des signes québécoise et américaine
(pour les femmes sourdes) et inclut
deux versions descriptives pour les
femmes ayant un handicap visuel.
De plus, il est sous-titré en français
et en anglais.
Autour des seins, est le fruit de la
collaboration de 13 groupes et d’une
jeune équipe d’artistes. On y rencontre
des femmes de 20 à 72 ans de cultures
variées, des femmes ayant un handicap
physique, des femmes qui voient le
dépistage du cancer du sein chacune
à leur manière. Ce sont ces différents
regards qui font la richesse et la sim-
plicité de ce DVD de 22 minutes.
Un programme de formation médicale
continue à la fine pointe du progrès
www.mammographieetcancerdusein.com